28/01/2009
_Heinlein's children : The juveniles_
Heinlein's children : The juveniles : Joseph T. MAJOR : Advent : 2006 : 0-911682-34-1 : 535 pages (dont index & bibliographie utilisée) : à commander chez l'éditeur pour une bonne trentaine d'Euros pour un HC avec jaquette : Nominé aux Hugos en catégorie Non-fiction.
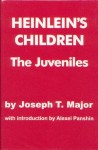
Ce livre est un recueils d'essais traitant chacun d'un des 'juveniles' de RAH (on notera que Starship troopers est considéré comme en faisant partie). Les textes sont initialement parus entre 1993 & 1999 dans le fanzine FOSFAX.
La provenance des textes est importante parce qu'elle conditionne le ton du livre. Au lieu d'une étude académique sur les romans en question, le format de chaque article est plutôt celui d'une sorte de lecture des romans de Heinlein commentée en public par Major.
En effet, l'auteur nous raconte chaque livre avec force détails et y introduit divers ajouts, soit pertinents (en relation avec des positions ou d'autres écrits de RAH), soit complètement gratuits et qui ne volent pas plus haut que toute discussion sociétale au bar du coin ("ah, c'était mieux avant", "ces communistes y veulent tout nous prendre", "Reagan c'était un VRAI président").
N'ayant lu qu'une petite partie des juveniles en question (Space cadet, Citizen of the galaxy et Starship troopers) ce babillage permanent m'a plutôt tapé sur les nerfs. Avec les connaissances de Major tant sur RAH que sur la SF, il y avait probablement de quoi faire un ouvrage plus sérieux et plus fouillé en laissant tomber la discussion entre copains et la paraphrase pour une analyse plus en profondeur et surtout plus étayée.
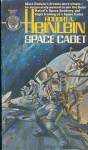
Le manque de substance est d'autant plus gênant que Major tombe dans un travers fréquent chez les admirateurs de RAH, à savoir le fait de considérer tout détracteur des écrits du maître comme étant limité intellectuellement et donc incapable de comprendre toutes les subtilités de la divine parole. Cette technique est utilisée dans le livre pour discréditer les avis de gens comme Dish, Blish, Knight ou Spider Robinson (point amusant pour celui qui est presque l'héritier officiel), qui, selon Major, n'ont 'rien compris' ou 'pas lu' les ouvrages en question. Ce traitement des hérétiques est devenu une constante, et se trouve fréquemment utilisé comme par exemple pour les romans tardifs de RAH qui sont présentés comme "trop ambitieux ou trop élitistes pour certains critiques" (=ceux qui en on dit du mal).
Manquant du background nécessaire et de la patience suffisante pour endurer des pages de digressions, je ne suis donc pas le critique idéal pour ce livre qui ne m'a guère impressioné. Pour d'autres avis, il faudrait peut-être aller voir au 17 rue Dante à Nice http://heinlein.free.fr/index.php.
Note GHOR : 1 étoile
11:03 | 11:03 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile, heinlein | Tags : anglais, 1 étoile, heinlein
15/01/2009
_Bibliographie des collections spécialisées 1913-1968_
Bibliographie des collections spécialisées 1913-1968 : A&A, collection Documents SF : Francis VALERY & Georges PIERRU : 1978 (pas de date sur l'ouvrage lui-même) : pas d'ISBN (DL à parution) : 60 pages : prix variable (du fait d'une certaine rareté, trouvé à 3 Euros) pour un chapbook agrafé.

Il s'agit d'une liste des titres parus dans les collections clairement identifiées comme SF, sous réserve que ladite collection ait été créée avant 1968 (il y a donc J'ai Lu mais pas Le Masque). Il faut noter que si les collections doivent dater d'avant 1968, les titres listés vont jusqu'en 1977 (à peu près).
Pour chaque collection (rarement présentée), sont donnés la liste des ouvrages parus avec le numéro dans la collection, le titre et l'auteur (sauf pour J'ai Lu -?-, où il y a en plus la première parution en VF) et c'est tout. Ce qui veut dire que ne sont pas donnés la date de parution VF ou VO, le TO, le format, la pagination, sans parler d'un éventuel ISBN.
C'est donc un livre qui pourrait être vu comme un proto Bisceglia (Trésors du roman policier, de la science-fiction et du fantastique), un livre remarquable qui ne sortira que trois ans plus tard. Le tout avec une couverture moins large du fait de l'exclusion de certaines collections et globalement moins d'infos périphériques.

Tentative sympathique, ce livre présente toutefois de trop nombreux défauts :
- Police de couleur rouge sur les deux tiers (une solution anti-photocopillage ?) et qualité d'impression très mauvaise.
- Utilisation d'une machine à écrire qui a dû voir des jours meilleurs (caractères écrasés, défauts d'alignement).
- Fautes de frappe (Colosus)
- Erreurs bibliographiques 'basiques' (surtout pour des gens du calibre de Valéry), comme l'attribution du roman Sixième colonne à Anson Mc Donald pour la VF, ou l'indication "non sorti" appliquée à D'une planète à l'autre.
- Ergonomie déplorable, liée à l'absence d'index et à des détails irritants qui font que, par exemple, pour trouver une collection rapidement, il faut connaître la date de première parution du premier ouvrage qui la compose.

C'est donc un achat à réserver à des nostalgiques ou des complétistes. C'est aussi un témoignage historique qui permet d'assister aux débuts de la bibliographie en VF, mais ce n'est en aucun cas un ouvrage utilisable au quotidien. Même pour des titres de la période couverte, on lui préfèrera Le Rayon SF ou L'argus de la SF.
Note GHOR : 1 étoile
13:22 | 13:22 | Index, dictionnaires & bibliographies | Index, dictionnaires & bibliographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile | Tags : français, 1 étoile
08/01/2009
_Les 100 principaux titres de la science fiction_
Les 100 principaux titres de la science fiction : Annick BEGUIN : Cosmos 2000 : 1981 : pas d'ISBN : 30 pages : format A5 agrafé avec couverture cartonnée : trouvable par hasard pour un prix variable (visiblement 10 francs pour mon exemplaire).

Cet ouvrage fait partie d'une catégorie assez fréquente, celle des listes de best-of. Ici, comme le titre l'indique clairement, c'est un listing des 100 meilleurs titres de SF (romans ou recueils, obligatoirement traduits et jusqu'en 1980), un format qui sera par exemple repris sous une forme plus restrictive (romans uniquement) par Andrews et Rennison pour leur 100 must-read SF novels.

Il s'agit donc de la liste personnelle d'Annick BEGUIN qui animait la librairie Cosmos 2000 à Paris (c'était derrière l'arc de triomphe), le haut-lieu de la SF dans la capitale dans les années 80, il a d'ailleurs même existé un prix Cosmos 2000 (IIRC).
Formellement cette énumération des 100 meilleurs livres se présente sous la forme d'une suite de petits (quelques lignes au plus) résumés de chaque ouvrage quasiment sans avis critique (normal ce sont les meilleurs), le tout étant classé par auteur puis par ordre chronologique.
Les informations bibliographiques fournies sont limités à la date de première parution originale (plus ou moins discutable, par exemple pour les fix-ups) et visiblement aux éditions "accessibles" (par exemple pour Fondation n'est mentionnée que l'édition PdF). Pas de numéro dans la collection, pas d'ISBN, pas de titre original, pas d'indication de type (recueil ou roman). L'appartenance à une série et les autres titres dans le même univers sont (parfois) indiqués. Dans le cas d'un recueil, il arrive que les nouvelles qui le compose soient listées, avec un degré de précision variable.

Comme dans tous ces ouvrages, il s'agit d'un choix assumé et qui appelle dès la préface les commentaires sur la sélection présentée.
C'est donc à la fois une sélection pour partie très classique avec sa proportion habituelle d'ouvrages primés (Hugo & Nebula) ou ses classiques reconnus (Demain les chiens, Fondation, Jack Baron et l'éternité,...) ce qui correspond probablement aux titres les plus représentatifs selon l'auteur, et pour partie plus nettement plus personnelle et beaucoup moins consensuelle. Je placerais dans cette catégorie des titres comme Flûte, flûtes et flûtes, Colonie, Polymath, Ose, La naissance des dieux ou Les gardiens, qui sont tous dans mon expérience des titres peu fréquents dans ce genre de palmarès. Le sommet de l'audace étant certainement l'inclusion dans les 100 meilleurs titres de la SF du terrible (à tous les sens du terme) Ténèbres sur Diamondia, peut-être le Van Vogt le plus jouissif mais aussi le plus fumeux.
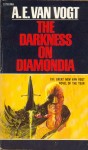
Plus intéressante est l'exclusion de certains ouvrages ou les choix opérés pour certains auteurs. Par exemple (que je choisis explicitement pour faire de l'audience) seuls deux livres de RAH sont dans ce classement : Marionnettes humaines et En terre étrangère, deux livres que je ne mettrais absolument pas dans les meilleurs de l'auteur même si le second est (littéralement) "culte".
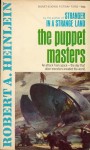
On pourrait aussi s'étonner de l'absence de certains auteurs : Niven, Pohl, Kornbluth, Russell, Harrison, Dickson... dont la typologie laisserait penser à un rejet de ce que l'on pourrait caricaturer comme étant l'école Analog (et pourtant il y a Bova).
Le poids relatif des auteurs est parfois particulier puisque Farmer et Van Vogt ont 5 ouvrages sélectionnés chacun (soit 10% des principaux titres du genre), contre 2 à Heinlein ou 1 seul à Williamson.
En tout cas, une vision de la SF cohérente avec son placement temporel (avant les années 80) et avec les ouvrages disponibles à l'époque. Une sélection peut-être plus intéressante par ce qu'elle laisse entrevoir sur une certaine perception de la SF que véritablement par son contenu.
Note GHOR : 1 étoile
15:21 | 15:21 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile | Tags : français, 1 étoile
07/01/2009
_Une succursale du fantastique nommée science-fiction_
Une succursale du fantastique nommée science-fiction : Jacques STERNBERG : Le Terrain Vague : 1958 : 63 pages (+ photos) : un semi-poche pas forcément évident à trouver vu son âge, acheté pour 15 Euros.

Il s'agit là d'un des premiers (si ce n'est le premier, j'ai la flemme de vérifier, voir peut-être La littérature française d'anticipation scientifique de Bridenne qui date aussi de 1958) ouvrage consacré uniquement à la SF, avec le but avoué de faire connaître et apprécier le genre lors de son (re ?) introduction (dans sa variante anglo-saxonne) dans notre pays, à la suite de l'apparition des premières collections clairement estampillées SF (Fleuve Noir Anticipation, Rayon Fantastique, Présence du Futur).
Le livre est assez mince et très aéré, mais avec des jolies photos (en N&B et bizarrement légendées au recto). Structurellement, il se présente d'une façon similaire à ces ouvrages d'introduction. Il commence par tenter de définir la SF (en discutant l'étymologie du terme), chose plus pertinente qu'il n'y parait en 1958, puis il essaie d'en cerner les origines et en montre les qualités (via une suite de résumés des grandes nouvelles de SF).
On notera que la subordination avec le fantastique, implicite dans le titre, est largement ignorée dans le corps du texte.
Vu le peu de matière, il n'y a pas grand chose à dire sur cette étude, si ce n'est qu'elle est cohérente avec l'état de l'art de la réflexion sur la SF des années 50.
En gros, il y a un certain nombre d'erreurs ou d'approximations, une focalisation bienvenue sur les nouvelles (présentées, AMHA à juste titre, comme le coeur du genre) et un certain nombre d'attaques sur des cibles habituelles : Bradbury (à rebours des goûts littéraires prévalants), le FNA (déjà critiqué pour son populisme à l'époque).
J'ai été gêné par les lauriers insistants (2 pages quand même) tressés par Sternberg à la collection Présence du Futur. Un esprit chagrin comme le mien pourrait y voir un lien avec le fait qu'il y ait été publié. Comme quoi le passage de brosse ou le renvoi d'ascenseur (je te publie et tu parles de moi, je t'édite et tu m'édites) est une pratique qui, dans le microcosme de la SF, a toujours été d'actualité.

Un ouvrage qui ne présente qu'un intérêt historique.
Note GHOR : 1 étoile
09:44 | 09:44 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile, sternberg | Tags : français, 1 étoile, sternberg
02/01/2009
_Intersections : fantasy and science fiction_ & _Bridges to science fiction_
Intersections : fantasy and science fiction : George E. SLUSSER & Eric S. RABKIN : Southern Illinois University Press : 1987 : 252 pages (y compris index) : ISBN 0-8093-1374-X : en occase pour quelques dizaines d'euros pour un HC avec jaquette.

Bridges to science fiction : George E. SLUSSER & George R. GUFFEY & Mark ROSE : Southern Illinois University Press : 1980 : 168 pages (y compris index) : en occase pour quelques dizaines d'euros pour un HC avec jaquette.

Un avis global sur deux livres similaires dans leur principe et le résultat obtenu. Ces ouvrages sont donc des recueils d'essais contenant chacun une dizaine de textes (plus nombreux et plus courts dans le premier que dans le second). Ce dernier (Bridges) correspond (IIRC) aux minutes de la toute première conférence sur le fantastique dans les arts, ce qui peut expliquer la piètre qualité des contributions, prévisible pour une manifestation dans sa première instance.
Ce sont donc des livres purement académiques, à la fois par le fait que le public ciblé est celui des bibliothèques universitaires et par le fait que l'on puisse penser qu'une publication dans ces supports rapporte des points pour une carrière. Du coup, les essais sont souvent (logique à l'époque) écrits par des gens dont les domaines de compétences ne sont généralement pas la SF. Seules exceptions, les universitaires dont le champ d'étude est justement la SF (Slusser, Rabkin) et quelques auteurs comme ici Benford ou Zelazny.
C'est sans doute pour cela que je ne leur trouve aucun intérêt, le canevas de chaque court article étant le même, un début avec un très vague rapport avec la SF et une bifurcation immédiate vers le domaine de prédilection (ou de spécialité) de l'auteur. Ceci nous vaut par exemple des pages de citations en latin, des essais sur Faulkner, sur Gravity's rainbow ou sur Shakespeare, certainement très érudits, mais qui, au final, n'apportent absolument aucun éclairage sur la SF. De toute façon, de leur aveu écrit même, certains intervenants connaissent peu très peu le genre.
Seuls quelques essais arrivent à surnager (celui de Delany par exemple) dans cette mer de médiocrité. C'est dommage parce que le premier ouvrage (qui est nettement le meilleur des deux) aurait pu ouvrir des pistes sur les relations entre SF & Fantasy avec une discussion (hélas avortée) du genre hybride qu'est la Science-Fantasy. Il est probable qu'à l'époque la réflexion sur ce thème était trop peu developpée (surtout du côté Fantasy) pour pouvoir aboutir.
Deux ouvrages que l'on peut aisément éviter, si ce n'est pour faire joli et sérieux dans une bibliothèque.
Note GHOR : 1 étoile pour Intersections, 0 étoile pour Bridges to science fiction.
10:01 | 10:01 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile, 0 étoile | Tags : anglais, 1 étoile, 0 étoile


